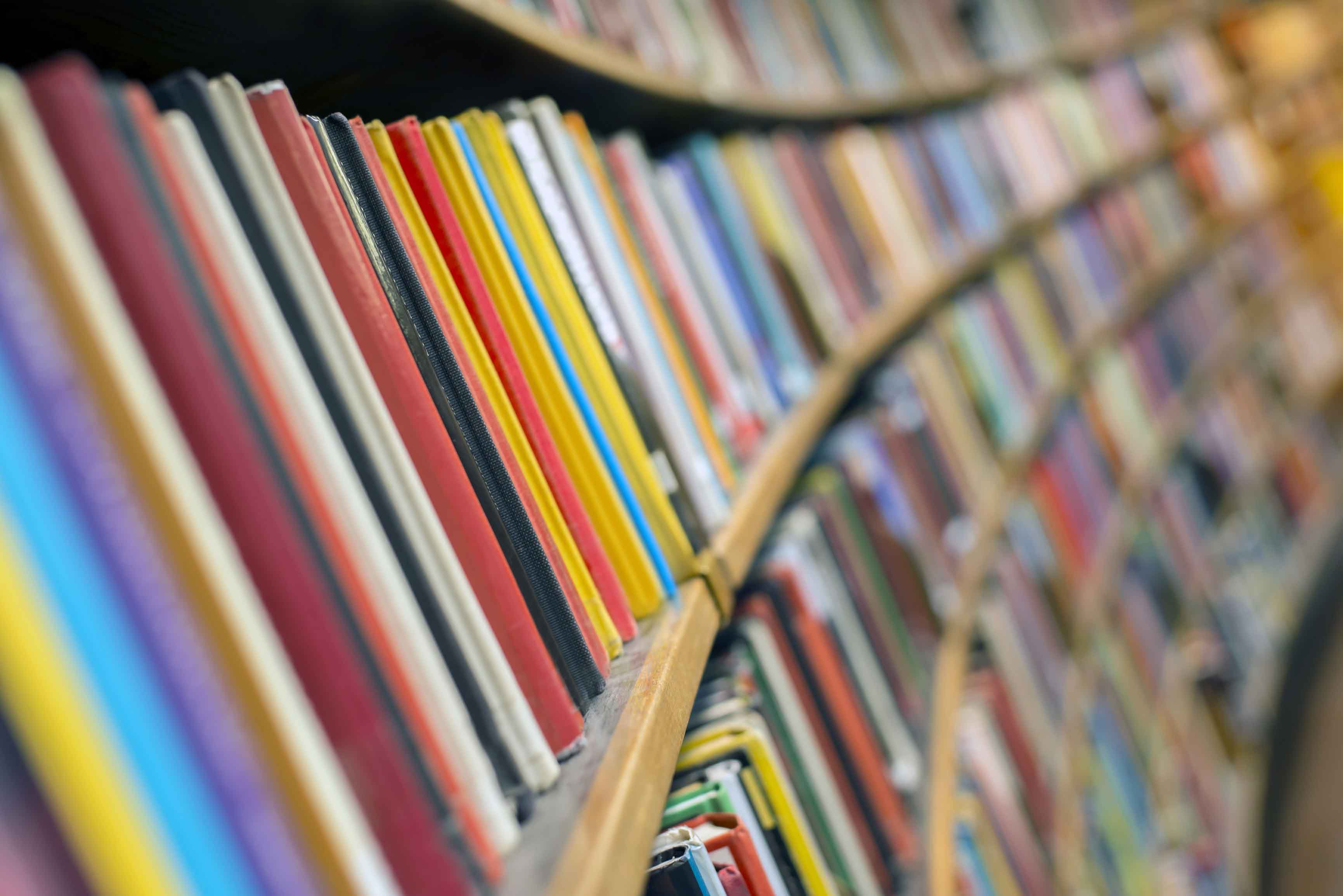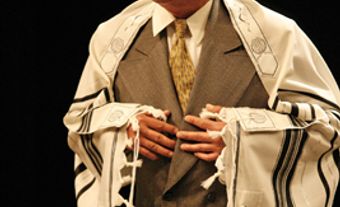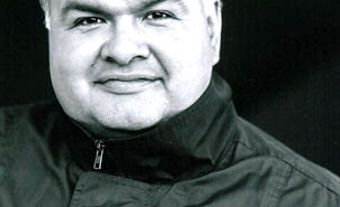Alanis Obomsawin, C.C., G.O.Q., cinéaste, chanteuse, artiste, conteuse (née le 31 août 1932 près de Lebanon, au New Hampshire). Alanis Obomsawin est l’une des cinéastes documentaires les plus éminentes au Canada. Elle a commencé sa carrière en tant que chanteuse et conteuse professionnelle avant de se joindre à l’Office national du film (ONF) en 1967. Ses films primés abordent les luttes des peuples autochtones au Canada selon leur point de vue, et ils mettent en valeur leurs voix qui ont depuis si longtemps été marginalisées. Alanis Obomsawin a été nommée Compagnon de l’Ordre du Canada et de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, ainsi que Grande officière de l’Ordre national du Québec et Commandeure de l’Ordre de Montréal. Elle est lauréate du prix Albert-Tessier, du Prix humanitaire décerné par les prix Écrans canadiens, de plusieurs prix du Gouverneur général, de prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations, et de diplômes honorifiques, parmi bien d’autres nombreux honneurs.

Jeunesse
À l’âge de six mois, Alanis Obomsawin, membre de la nation des Abénakis et dont le nom de famille signifie « éclaireur », retourne avec sa famille sur la réserve d’Odanak près de Sorel, au Québec. Son père est guide et fabricant de remèdes, tandis que sa mère dirige une pension. Le temps passé sur la réserve est idyllique : la jeune Alanis livre le pain fait maison de sa tante et chante avec abandon dans le fauteuil berçant de celle-ci.
À l’âge de neuf ans, la famille d’Alanis quitte la réserve et déménage à Trois-Rivières. Bien que la transition soit difficile, c’est la mort de son père causée par la tuberculose alors qu’elle a 12 ans qui fait qu’Alanis se rebelle contre l’intimidation et la promotion de la supériorité de la culture européenne à l’école. À 22 ans, elle quitte Trois-Rivières et elle étudie l’anglais en Floride avant de s’installer à Montréal vers la fin des années 1950.
Carrière musicale
Après ses débuts en tant que chanteuse lors d’un concert au Town Hall de New York en 1960, Alanis Obomsawin fait des apparitions dans des réserves, des écoles, des prisons, des festivals de musique, et à la télévision. En 1966, elle est présentée à l’émission Telescope de la CBC pour son activisme et ses efforts « presque surhumains » pour financer, par le biais de dons, de concerts et de conférences, une piscine pour la réserve d’Odanak dont la rivière locale est déclarée trop polluée.
Elle se produit à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, s’accompagnant elle-même avec un tambour à main ou un hochet. Son répertoire inclut des chansons autochtones traditionnelles ainsi que des histoires qu’elle raconte en anglais et en français. Son album de 1984, Bush Lady, est peut-être le meilleur exemple de son style musical. Accompagnée de son tambour à main, et parfois d’une flûte, d’un hautbois, d’un violon et d’un violoncelle, Alanis Obomsawin chante et raconte des histoires dans plusieurs langues. Dans « Mother of Many Children », un morceau qui combine le chant et la poésie orale en français, elle commence en anglais : « From earth, from water, our people grew to love each other in this manner. For in all our languages, there is no he, or she. We are the children of the earth, and of the sea. »(De la terre, de l’eau, notre peuple a appris à s’aimer de cette manière. Car dans toutes nos langues, il n’y a pas de lui ou d’elle. Nous sommes les enfants de la terre, et de la mer)
Bien qu’elle soit surtout connue pour ses réalisations cinématographiques, Alanis Obomsawin n’abandonne pas ses racines de la scène. Elle se produit au Festival du printemps de Guelph, au Centre national des arts à Ottawa, à la Place des Arts à Montréal, au Festival de folklore Mariposa (où elle est coordonnatrice de la programmation autochtone de 1970 à 1976) et au WOMAD (Harbourfront, 1990). Elle apparaît également régulièrement dans la version canadienne de l’émission pour enfants Sesame Street pendant plusieurs années au cours des années 1970.
En novembre 2017, Alanis Obomsawin donne son premier concert en 30 ans : elle interprète son album Bush Lady dans son intégralité au festival Le Guess Who? à Utrecht, aux Pays-Bas. Elle reçoit une ovation debout de la foule qui compte 800 personnes, et elle dit plus tard à la Montreal Gazette : « Lorsqu’ils se sont tous mis debout, j’ai cru que j’allais m’évanouir. J’étais tellement émue. Je ne pouvais pas m’imaginer que ça leur plairait autant. »
L’album Bush Lady est réédité sur vinyle, CD, et formats numériques par la maison de disques montréalaise Constellation Records en juin 2018, afin de marquer le 30e anniversaire de l’album. Alanis Obomsawin l’interprète également le 28 septembre 2018 au Monument-National à Montréal à l’occasion du festival de musique POP Montréal. L’artiste reçoit de nombreuses demandes de performance, mais elle n’en accepte que de manière sélective. « Ce n’est pas facile pour moi », dit-elle à la Gazette en septembre 2018. « Ce que je chante n’est pas facile. Je ressens chaque mot. J’ai toujours peur de me mettre à pleurer. »
Carrière de cinéaste
En 1966, après avoir vu Alanis Obomsawin à Telescope, une série de la CBC, Wolf Kœnig et Bob Verrall, producteurs à l’Office national du film (ONF), l’embauchent comme consultante sur des projets liés aux peuples des Premières Nations. En 1971, elle réalise son premier film, Christmas at Moose Factory, et en 1977, elle devient membre du personnel permanent de l’ONF.
Alanis Obomsawin s’engage à rectifier l’invisibilité des peuples autochtones, et son style cinématographique réside dans son habileté unique à jumeler les traditions orales des Autochtones aux méthodes du cinéma documentaire. Dans Amisk et Mother of Many Children, films produits et réalisés en 1977, elle combine des entrevues avec de la musique, de la danse, des dessins, et des images d’archives pour valider l’histoire des peuples autochtones à travers le Canada.
Parmi ses films au sujet des jeunes, Richard Cardinal : Cry from a Diary of a Métis Child (1986) est le plus reconnu, et peut-être le plus marquant. Ce récit dramatique sur le suicide d’un jeune garçon mène à un rapport gouvernemental sur les services sociaux pour enfants autochtones placés en familles d’accueil en Alberta, bien que peu soit fait pour atténuer le problème (voir aussi Suicide chez les Autochtones au Canada). Les films d’Alanis Obomsawin documentent le travail des organismes autochtones qui aident les jeunes à surmonter l’alcoolisme et l’abus de drogues (Poundmaker’s Lodge: A Healing Place, 1987) et qui offrent des services aux personnes autochtones qui sont itinérantes à Montréal (No Address, 1988). Ses films sur les luttes des Mi’kmaq pour les droits de pêche (Incident at Restigouche, 1984) et sur l’affrontement entre les Mohawks et le gouvernement à Oka en 1990 (Kanehsatake : 270 Years of Resistance, 1993 [v.f.; Kanehsatake, 270 ans de résistance]) sont largement acclamés, et ils valent à Alanis Obomsawin une reconnaissance à l’échelle nationale et internationale.
Alanis Obomsawin réalise The Wild Rice Harvest, Kenora (1979) et June in Povungnituk (1980) pour la série Vignettes de l’ONF, ainsi que le court métrage dramatique Walker (1991). Elle raconte les histoires d’individus (My Name Is Kahentiiosta, 1995; Spudwrench, 1997) et commente les effets à long terme d’incidents spécifiques survenus lors de la Crise d’Oka de 1990 (Rocks at Whiskey Trench, 2000), permettant ainsi aux spectateurs de percevoir les multiples angles d’une histoire complexe et évolutive.
Elle réexamine certains des thèmes précédents dans son œuvre sur le sujet des droits de pêche autochtones au Canada dans Is the Crown at War with Us? (2002). Elle donne suite à ce documentaire en se concentrant sur le droit des autochtones de gérer et d’utiliser les ressources naturelles de leurs terres ancestrales dans Our Nationhood (2003). Elle complète également deux films au sujet du peuple d’Odanak : Waban-Aki : People from Where the Sun Rises (2006); et Gene Boy Came Home (2007). Ce dernier raconte l’histoire de l’ancien combattant Eugene « Gene Boy » Benedict qui revient d’une mission de presque deux ans à la guerre du Vietnam, et qui lutte pour retourner à Odanak dans les années qui suivent son service militaire. Alanis Obomsawin continue à réaliser des films jusqu’à ses 80 ans, notamment Hi-Ho Mistahey! (2013), qui porte sur l’initiative d’éducation des Autochtones de Shannen’s Dream, et Trick or Treaty? (2014) qui raconte les luttes des dirigeants autochtones pour tenter de négocier avec le gouvernement fédéral. Trick or Treaty? est sélectionné pour être présenté dans le Programme des maîtres du Festival international du film de Toronto (TIFF) en septembre 2014. Alanis Obomsawin est la première cinéaste autochtone à recevoir cet honneur. Le film se classe deuxième pour le prix People’s Choice Documentary du TIFF, et il est sélectionné pour un prix Écrans canadiens dans la catégorie du meilleur long métrage documentaire.
Le film d’Alanis Obomsawin The People of the Kattawapiskak River (2012), un film pour l’ONF d’une durée d’une heure, explore les conditions de pauvreté dans lesquelles vivent les Cris de Kattawapiskak du nord de l’Ontario, et il remporte le prix Donald-Brittain dans la catégorie du meilleur documentaire social/politique à la cérémonie des prix Écrans Canadiens de 2014 (voir aussi Donald Brittain). Son documentaire tourné en 2016, We Can’t Make the Same Mistake Twice, raconte la lutte d’une durée de neuf ans pour les droits de la personne alléguant que le gouvernement fédéral a sous-financé les enfants autochtones au Canada. Le film est projeté en première mondiale au TIFF, et il est acclamé par la critique.
Arts visuels
Alanis Obomsawin est également une artiste visuelle prolifique, reconnue pour ses gravures et ses estampes. Le Musée des beaux-arts de Montréal présente, du 21 mai au 25 août 2019, une exposition d’environ 25 de ses estampes, ainsi que des objets de paille et d’herbes faits à la main et fabriqués par des membres de la nation des Abénakis.
Activités administratives
Alanis Obomsawin est depuis longtemps une force active dans la communauté artistique du pays, et elle siège au conseil d’administration de plusieurs organismes. Elle est membre du conseil d’administration de Studio One, l’unité autochtone de l’ONF, en plus d’être conseillère pour le programme New Initiatives in Film, un programme pour les femmes de couleur et les femmes autochtones dans l’unité des femmes de l’ONF, le Studio D. Elle est membre du conseil d’administration de Aboriginal Voices, du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), de l’Association de radiotélévision publique du Québec, de la National Geographic International, et du Public Broadcasting System (PBS) au Vermont. Elle est également présidente du conseil d’administration du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, et elle siège au conseil du Comité consultatif des Premières Nations du Conseil des Arts du Canada.
Honneurs et reconnaissance
Alanis Obomsawin est une figure vénérée parmi les cinéastes documentaires et elle reçoit de nombreux honneurs à la fois aux États-Unis et au Canada. Elle est nommée membre de l’Ordre du Canada en 1983, est promue à Officier en 2001, et ensuite à Compagnon (la plus haute distinction civile du Canada) en 2019. Ses réalisations artistiques, son travail auprès des jeunes Autochtones, et son activisme en faveur des droits des Autochtones lui méritent le Prix du Gouverneur général (1983), le National Aboriginal Achievement Award (1994), et plus d’une douzaine de diplômes honorifiques. Elle reçoit également une bourse honoraire du Ontario College of Art and Design en 1994, et elle est nommée membre honoraire de la Société royale du Canada en 2013.
En 2001, elle reçoit le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques, et elle devient la première personne qui ne soit ni sociologue ni anthropologue à remporter le Prix de contribution remarquable de la Société canadienne de sociologie et d’anthropologie (voir aussi Sociologie; Anthropologie). En 2004, la International Documentary Association lui décerne son Pioneer Award, décerné annuellement à « une personne qui a marqué de façon indélébile l’art et le métier de la cinématographie documentaire. » Cette même année, le imagineNATIVE Film + Media Arts Festival de Toronto crée un prix annuel du documentaire en son honneur.
En mai 2008, Alanis Obomsawin reçoit un autre prix du Gouverneur général, le Prix pour les arts du spectacle pour sa réalisation artistique. Ce même mois, elle fait également l’objet d’une rétrospective spéciale d’une durée de deux semaines au Musée d’art moderne de New York. Aussi en 2008, elle participe au Programme des aînés en résidence de la First Nations House of Learning de l’Université de la Colombie-Britannique. En 2009, elle reçoit le Prix de la réalisation exceptionnelle du Hot Docs Canadian International Documentary Film Festival. En 2012, elle retourne à l’Université de la Colombie-Britannique en tant qu’artiste en résidence pour le programme de production cinématographique.
En 2014, Alanis Obomsawin reçoit le Prix humanitaire des prix Écrans canadiens pour sa « contribution exceptionnelle à la communauté et au service public ». En 2016, la Toronto Film Critics Association lui décerne le prix Technicolor Clyde Gilmour qui honore les cinéastes « dont l’œuvre a enrichi d’une certaine façon la compréhension et l’appréciation du cinéma dans leur pays d’origine ». En tant que lauréate de ce prix, elle doit choisir un·e cinéaste émergent·e pour lui accorder un prix de 50 000 $ en biens et services offerts par Technicolor; elle choisit l’artiste métisse et crie Amanda Strong. Cette même année, Alanis Obomsawin est nommée Grande officière de l’Ordre national du Québec et elle reçoit le prix Albert-Tessier, la plus haute distinction québécoise dans le domaine du cinéma (voir aussi Prix du Québec).
En 2017, Alanis Obomsawin devient membre de la Documentary Branch of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Elle est également nommée Commandeure de l’Ordre de Montréal. En 2018, elle reçoit le prix Simone de Beauvoir Institute de l’Université Concordia, en reconnaissance de son importante contribution au développement du féminisme au Canada.
Le 5 novembre 2018, une murale honorant Alanis Obomsawin est dévoilée au coin des avenues Lincoln et Atwater, près de son domicile. Conçue par Meky Ottawa, une artiste atikamekw, la murale est une image composite d’Alanis Obomsawin en spectacle au Festival de folklore Mariposa en 1970, et de la photo d’elle jouant avec des enfants dans un pensionnat indien pendant le tournage de son documentaire Christmas at Moose Factory en 1971. « Ces enfants sont tous grands-parents maintenant, dit Alanis Obomsawin à CBC News, alors j’espère qu’ils pourront venir la voir.
En octobre 2021, Alanis Obomsawin reçoit le prix Glenn Gould de 100 000 $ pour sa contribution de toute une vie aux arts au Canada. Dans le cadre de ce prix, elle doit choisir la personne lauréate du prix Glenn Gould Protégé de 15 000 $ de la ville de Toronto. Elle choisit la cinéaste ojibwée Victoria Anderson-Gardner. En avril 2023, Alanis Obomsawin devient la première femme cinéaste à remporter la prestigieuse Edward MacDowell Medal, qui est décernée par le plus ancien programme d’artistes en résidence aux États-Unis à un artiste ayant apporté une contribution exceptionnelle à son domaine. Parmi les anciens récipiendaires de cette médaille, on compte Robert Frost, Georgia O’Keefe, Toni Morrison, et David Lynch.
Prix
- Membre, Ordre du Canada (1983)
- Prix du Gouverneur général (1983)
- Meilleur long métrage canadien (Kanehsatake : 270 Years of Resistance), Festival international du film de Toronto (1993)
- Meilleur long métrage documentaire (Kanehsatake : 270 Years of Resistance), Vancouver International Film Festival (1993)
- Prix pour réalisation exceptionnelle en direction, Toronto Women in Film and Television (1994)
- Prix national d’excellence décerné aux Autochtones, Fondation nationale des réalisations autochtones (1994)
- Officier, Ordre du Canada (2001)
- Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques (2001)
- Prix de contribution remarquable, Société canadienne de sociologie et d’anthropologie (2001)
- Prix Milestone, imagineNATIVE Film + Media Arts Festival (2004)
- Pioneer Award, International Documentary Association (2004)
- Luminaria Tribute for Lifetime Achievement, Santa Fe Film Festival (2007)
- Réalisation artistique, Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (2008)
- Prix pour réalisation exceptionnelle, Hot Docs Canadian International Documentary Film Festival (2009)
- Playback, Temple de la renommée du cinéma et de la télévision du Canada (2010)
- Bourse Montgomery, Dartmouth College (2011)
- Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations, Women’s International Film & Television Showcase (WIFTS)
- Foundation International Visionary Awards (2013)
- Membre honoraire, Société royale du Canada (2013)
- Prix Audience Choice (Trick or Treaty?), imagineNATIVE Film + Media Arts Festival (2014)
- Prix Donald-Brittain pour le meilleur documentaire social ou politique (The People of Kattawapiskak River), prix Écrans canadiens (2014)
- Prix humanitaire, prix Écrans canadiens (2014)
- Prix pour une carrière exceptionnelle, Artistes pour la Paix (2015)
- Companion, Ordre des arts et des lettres du Québec (2015)
- Prix Technicolor Clyde Gilmour, Toronto Film Critics Association (2016)
- Grande officière, Ordre national du Québec (2016)
- Prix Albert-Tessier, Prix du Québec (2016)
- Commandeure, Ordre de Montréal (2017)
- Cinéaste de l’année, Playback (2017)
- Prix APTN (Our People Will Be Healed), Festival Présence autochtone (2018)
- DGC Honourary Life Member Award, Guilde canadienne des réalisateurs (2018)
- Prix Simone de Beauvoir Institute, Université Concordia (2018)
- Compagnon, Ordre du Canada (2019)
- Prix de la diversité Paul Gérin-Lajoie, ENSEMBLE (2018–2019)
- Prix d’un artiste de distinction, Vancouver Biennale (2019)
- Rogers-DOC Luminary Award, DOC Institute Honours Celebration (2020)
- Hommage Iris, Gala Québec Cinéma (2020)
- Jeff Skoll Award in Impact Media, Festival international du film de Toronto (2021)
- Prix Glenn Gould, Fondation Glenn Gould (2021)
- Edward MacDowell Medal, MacDowell (2023)
Diplômes honorifiques
- Doctorat en droit, Université Concordia (1993)
- Doctorat en lettres, Université Carleton (1994)
- Doctorat en lettres, Université York (1994)
- Doctorat en droit, Université Trent (2000)
- Doctorat en droit, University Queen’s (2000)
- Doctorat en droit, Université Western Ontario (2007)
- Doctorat en lettres, Université de Guelph (2008)
- Doctorat en lettres, Université de la Colombie-Britannique (2010)
- Doctorat en arts, Collège Dartmouth (2013)
- Doctorat en droit, Université Dalhousie (2016)
- Doctorat en lettres, Université McGill (2017)
- Doctorat en droit civil, Université Bishop (2018)
- Doctorat en droit, Université Ryerson (2018)
- Diplôme honoraire, Université Saint Thomas (2019)
- Docteure d’honneur, Université de Sherbrooke (2019)
- Doctorat en droit, Université de Toronto (2023)

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom