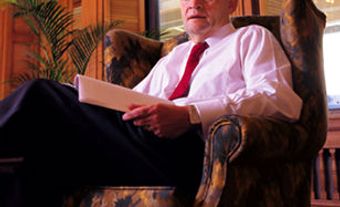La présence francophone en Colombie-Britannique remonte aux débuts de la colonisation du Nord-Ouest Pacifique par des groupes d’origine européenne au tournant du 19e siècle. Les Canadiens français, les Iroquois, les Métis et autres Autochtones d’expression française œuvrant dans le commerce des fourrures, ainsi que les missionnaires catholiques venus convertir les populations autochtones millénaires, feront du français la langue européenne la plus répandue dans la région jusqu’à la fin des années 1850.
La ruée vers l’or sur le fleuve Fraser et la création officielle de la Colombie-Britannique en 1858 entraînent toutefois une diminution importante de la proportion de francophones dans la population, de même que leur rapide assimilation linguistique. Mais tout au long du 20e siècle, de nombreux francophones continuent de s’installer et de vivre en Colombie-Britannique. Dotée de nombreuses associations culturelles et d’une fédération provinciale, la communauté mène une lutte active pour sa reconnaissance, particulièrement en matière de droits scolaires.
Selon l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, plus de 70 000 Britanno-Colombiens ont le français comme langue maternelle, en plus des quelque 300 000 habitants de la province affirmant connaître la langue. Depuis ses débuts, cette communauté s’est caractérisée autant par sa diversité sociale et culturelle que par sa dispersion à travers le territoire de la Colombie-Britannique.
Population
Selon le recensement canadien de 2016, le français est la langue officielle de 1,4 % de la population de la Colombie-Britannique (64 325 personnes), et 7 % (314 925 personnes) parlent à la fois l’anglais et le français. Entre 2006 et 2016, il y a eu une augmentation de 9 % parmi les personnes dont la langue maternelle est le français (64 213 personnes), et de 21 % parmi ceux qui parlent le plus souvent français à la maison (21 219 personnes).
Depuis ses débuts, cette communauté s’est caractérisée autant par sa diversité sociale et culturelle que par sa dispersion à travers le territoire de la Colombie-Britannique. La plupart des locuteurs francophones habitent dans la région du Lower Mainland et du sud-ouest (58 % de la population). Les autres régions économiques habitées par des locuteurs francophones sont l’île de Vancouver et la côte (20 %); Thompson-Okanagan (12 %); Kootenay (4 %); Cariboo (3 %); le nord-est (1 %); la côte nord (1 %) et Nechako (1 %). 12 % des locuteurs francophones sont nés dans la province, 59 % sont nés ailleurs au Canada, et 28 % sont nés à l’étranger. Parmi ceux nés à l’extérieur du Canada, 50 % des immigrants francophones en Colombie-Britannique proviennent d’Europe, 22 % d’Asie, 18 % d’Afrique et 10 % des Amériques.
Le commerce des fourrures
L’arrivée d’une population d’origine européenne en Colombie-Britannique débute avec l’expansion du commerce des fourrures à l’ouest des montagnes Rocheuses à la toute fin du 18e siècle. La Compagnie du Nord-Ouest (CNO), basée à Montréal, mandate successivement les explorateurs Alexander Mackenzie, Simon Fraser, et David Thompson pour partir à la recherche de passages à travers les montagnes permettant de relier le centre du Canada aux rives du Pacifique, et ainsi étendre son territoire commercial. Ces trois noms à consonance anglophone sont largement associés aux origines de la Colombie-Britannique moderne. Cependant, le succès de ces expéditions repose en grande partie sur le travail de guides, de rameurs ou d’interprètes auprès des Premières Nations réalisé par les employés de la Compagnie. Parmi eux se trouvent surtout des francophones, principalement embauchés à Montréal et envoyés à l’ouest par la CNO. En plus de Canadiens français, on y trouve des Métis, des Iroquois et des membres d’autres communautés autochtones s’exprimant en français et ayant participé aux expéditions antérieures à travers les plaines de l’Ouest canadien.
L’écossais Alexander Mackenzie est le premier officier de la CNO à être envoyé dans la région, voyageant en 1793 de fort Chipewyan en Alberta jusqu’au lieu actuel de Bella Coola sur la côte Pacifique. Dans son journal de bord, Mackenzie s’étend longuement sur les voyageurs faisant le trajet avec lui. En plus de son second, Alexander Mackay, et de deux guides autochtones qui ne sont pas nommés, six francophones accompagnent Mackenzie dans son canoë : Joseph Landry, Charles Ducette, François Beaulieux, Baptiste Bisson, François Courtois et Jacques Beauchamp.
Au début du 19e siècle, la CNO lance deux autres expéditions en Nouvelle-Calédonie, appelée à devenir la Colombie-Britannique quelques décennies plus tard. Celles-ci sont dirigées par David Thompson, un géomètre et commerçant de fourrures canadien anglais, et un autre explorateur écossais, Simon Fraser. En 1806, après avoir passé l’hiver dans la région aujourd’hui connue sous le nom de Hudson Hope, Fraser se dirige vers la partie nord des Rocheuses et atteint le lac Stuart en compagnie de plusieurs voyageurs. Fraser inscrit leurs noms comme suit : Bazile, La Londe, La Garde, Menard, St. Pierre, Saucier, Wananshis (Métis), Gagnon, Rivard et Blais. Fraser mentionne également un chef autochtone local connu sous le nom français de « Pouce Coupé ».
Deux ans plus tard, Fraser longe le fleuve qui porte aujourd’hui son nom, et une fois de plus le succès de cette expédition repose sur le travail des employés francophones de la CNO. Cette expédition de 24 personnes comprend Fraser lui-même, 19 voyageurs, deux autochtones et deux commis de la compagnie. Huit de ces voyageurs sont nommés dans le journal de Fraser : La Chapelle, Baptiste, D’Alaire, La Certe, Waka ou Wacca (le surnom de Jean-Baptiste Boucher), Bourboné (probablement Bourbonnais), Gagné et La Garde. L’équipe comprend également le Canadien français Jules-Maurice Quesnel, de qui provient le nom de la ville actuelle de Quesnel. En tant que commis au sein de la CNO, Quesnel constitue une exception à la traditionnelle répartition des tâches où les francophones sont relégués aux travaux manuels alors que les postes de direction reviennent généralement aux anglophones.
Entre-temps, David Thompson traverse les montagnes Rocheuses pour la première fois en 1807. Celui-ci descend le fleuve Columbia, fondant au passage Kootenay House, avec quatre Canadiens français : Moussau, Lussier, la Combe et Beaulieu – ce dernier qualifié d’employé « loyal » dont le nom sera donné à une rivière. Thompson fait de nombreux voyages à travers les Rocheuses, accompagné d’équipes pouvant atteindre 10 voyageurs.
Sous la direction de la CNO se développent les premières colonies non autochtones de la région, où les effectifs seront principalement des employés francophones. La reprise de la CNO par la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) en 1821 se traduit par une diminution du recrutement au sein des voyageurs francophones, bien que ces derniers restent néanmoins majoritaires parmi les colons établis dans les poste de traite situés entre la vallée du Fraser et l’île de Vancouver, remontant au nord jusqu’au Yukon.

Au poste de traite de fort Langley, où la Colombie-Britannique devient officiellement une colonie britannique en 1858, un forgeron du nom d’Étienne Pepin est désigné superviseur de la ferme, et de nombreux francophones œuvrent dans le milieu agricole. Si la bourgeoisie s’exprime surtout en anglais, ceci n’empêche pas le français de se faire entendre dans les demeures de l’élite aussi, en particulier celle de James Douglas. Agent principal de la CBH avant de devenir gouverneur de l’île de Vancouver puis de la Colombie-Britannique, Douglas, lui-même d’origine britannique et caribéenne, parle français avec son épouse métisse, Amelia Connolly, et utilise le français pour conduire certaines affaires coloniales officielles.
Si les langues autochtones et le chinook, de même que le gaélique, l’hawaiien et l’anglais sont largement utilisées dans la région, le français reste la lingua franca du commerce des fourrures. En 1846, les autorités britanniques parviennent à arrêter l’expansion américaine au nord du 49e parallèle grâce au Traité de l’Orégon. Pour beaucoup d’historiens, c’est le travail accompli par ces premières générations de francophones qui a empêché que la Colombie-Britannique ne fasse aujourd’hui partie des États-Unis.
Les missionnaires catholiques
Suivant de près l’arrivée des colons travaillant dans le commerce des fourrures, de nombreux missionnaires chrétiens s’installent dans la région. Étant donné que la majorité des colons parlent français et sont de tradition catholique, les missionnaires en provenance du Québec, ainsi que de France et de Belgique sont particulièrement attirés par la côte pacifique.
En 1838, les prêtres Norbert Blanchet et Modeste Demers sont envoyés du Québec à fort Vancouver (aujourd’hui, Vancouver, WA) avec comme directives de convertir les autochtones au catholicisme et de ramener dans le giron de l’Église les voyageurs Canadiens français établis dans la région. Après le traité de 1846, Demers est envoyé sur l’île de Vancouver où il devient le premier évêque de la colonie. Il attire avec lui des membres de deux ordres ecclésiastiques : les Oblats de Marie Immaculée, un ordre masculin basé en France, et les Sœurs de Sainte-Anne, une congrégation fondée quelques années plus tôt à Vaudreuil près de Montréal.
Dès leur arrivée, les Sœurs de Sainte-Anne se lancent dans l’éducation des enfants autochtones, ainsi que de ceux de parents Métis et de Canadiens français et anglais, ouvrant une classe dans leur petite maison en rondins. Pour leur part, les Oblats mettent sur pied des missions destinées à imposer un mode de vie européen aux Autochtones. Celles-ci constituent le fondement de plusieurs villes britanno-colombiennes, dont Mission ou encore Kelowna. Au départ, ces religieux utilisent principalement leur langue maternelle, mais à mesure que l’anglais devient la langue principale en Colombie-Britannique, les ordres s’adaptent en conséquence et commencent à recruter davantage d’anglophones.
La ruée vers l’or du fleuve Fraser
Alors que la nouvelle de la découverte d’or dans le fleuve Fraser se répand en 1858, le rythme de l’immigration s’intensifie. Des milliers de chercheurs d’or arrivent par la Californie, où l’or se fait de plus en plus rare, et d’autres viennent d’ailleurs en Amérique du Nord ou d’Europe. Bien que la frénésie minière ne dure que quelques années, l’afflux massif d’immigrants pose les fondations d’une province multiculturelle à l’économie diversifiée qui entre dans la Confédération canadienne en 1871.

Pour la population francophone, ces changements sont abrupts et elle perd rapidement son statut de principal groupe linguistique non autochtone. Ces transformations sont particulièrement profondes dans le sud de la province où la majorité de la population est concentrée. Plus au nord, dans les zones isolées, les comptoirs de commerce de la fourrure demeurent francophones plus longtemps, même si de nombreux employés de la CBH quittent la compagnie en espérant trouver fortune dans les eaux du fleuve Fraser. Bien qu’en proportion réduite dans l’ensemble de la population, l’immigration francophone en provenance du Québec et de l’Europe continue après la ruée vers l’or. Ces nouveaux venus ne se cantonnent plus dans le commerce de fourrure ou dans les activités de prosélytisme. En témoigne le cas de Jean Caux, surnommé Cataline, qui, avant l’arrivée du chemin de fer, devient l’un des paqueteurs les plus connus de la région, approvisionnant par train de mules les villages les plus éloignés de la colonie.
Maillardville
Grâce à la diversification de l’économie, le secteur des ressources est un pôle d’attraction pour les immigrants canadiens-français qui travaillent dans les mines et les forêts de la Colombie-Britannique. Au début du 20e siècle, d’anciens travailleurs du chemin de fer Canadien Pacifique établissent également de petites communautés francophones autour d’exploitations agricoles, notamment dans la vallée du fleuve Fraser, où l’on retrouve des noms de villages tels que Deroche et Durieu.
La plus importante concentration de francophones se trouve au lieu-dit Maillardville, quartier de la ville de Coquitlam en banlieue de Vancouver. Dans le racisme ambiant de l’époque, les patrons de la Canadian Western Lumber Company souhaitent se défaire de leur main-d’œuvre asiatique (voir Sino-Canadiens et Canadiens de l’Asie du Sud). Ils dépêchent un employé francophone et un prêtre catholique au Québec et dans l’est de l’Ontario pour y recruter des travailleurs Canadiens français expérimentés. En échange de salaires intéressants, de terrains abordables et de matériaux de construction, une quarantaine de familles s’y installe en 1909. Elles sont suivies d’un deuxième contingent l’année suivante. Un village francophone nommé en l’honneur du premier curé du village, un Oblat français du nom d’Edmond Maillard, prend rapidement forme, se dotant au fil du temps d’églises, d’écoles, de commerces et d’institutions culturelles. En 1931, une grève de deux mois dans les scieries locales mobilise la communauté francophone, dont les rangs sont renforcés par une nouvelle vague d’agriculteurs canadiens-français fuyant la sècheresse dans les Prairies. Depuis les années 1960, Maillardville s’est largement anglicisé, mais plusieurs descendants de ces familles continuent d’y habiter. Des maisons d’époque, construites en bois et d’inspiration canadienne-française, témoignent toujours de cette présence.
L’éducation en français
En dehors de l’enclave de Maillardville, l’éparpillement de la communauté francophone en Colombie-Britannique pousse ses membres à renforcer leurs rangs en fondant la Fédération canadienne-française de la Colombie-Britannique (aujourd’hui, Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, FFCB) en 1945. L’organisation fédère de nombreuses associations locales et organise une émission de radio hebdomadaire, des cours de français ainsi que des troupes de musique et de théâtre. Pour leur part, les résidents d’origine française gravitent autour de l’Alliance française, un organisme culturel international dont la division vancouvéroise, toujours en activité, existe depuis 1904.
Durant les années 1960, la FFCB concentre ses énergies sur un combat de longue haleine afin d’obtenir des écoles francophones publiques dans la province, laquelle ne reconnaît que les établissements scolaires à caractère non confessionnel, excluant d’office trois écoles paroissiales, situées à Maillardville et Vancouver et fonctionnant sans statut officiel. Dans un contexte de sécularisation et de la reconnaissance grandissante du bilinguisme par le gouvernement fédéral, la FFCB choisit de délaisser la lutte pour le financement des écoles catholiques au profit de revendications pour des écoles publiques de langue française, provoquant un certain remous dans ses rangs.
Si les premières écoles d’immersion française connaissent un certain succès dans la province, celles-ci sont destinées aux familles anglophones souhaitant que leurs enfants apprennent le français (voir Enseignement des langues secondes). La communauté francophone milite donc pour des écoles permettant aux enfants francophones d’être scolarisés dans leur langue maternelle. Une première victoire est acquise en 1978 avec l’annonce officielle du Programme cadre de français (PCF), créant des classes francophones à l’intérieur d’écoles anglophones. Le succès du PCF de même que les garanties constitutionnelles inscrites à la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 incitent la FFCB et les parents francophones à continuer de revendiquer un système géré indépendamment des conseils scolaires anglophones.
Ce n’est qu’après plusieurs années de pressions auprès du gouvernement provincial et des actions en justice menées par la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB), que le Conseil scolaire francophone (CSF) est créé en 1995. En 2016, plus de 5 500 élèves sont inscrits dans les 37 écoles primaires et secondaires du CSF réparties sur l’ensemble du territoire de la Colombie-Britannique. En 2010, de nouvelles actions en justice, toujours devant les tribunaux, sont intentées par le CSF et des parents d’élèves soutenant que le financement des écoles francophones de la province n’équivaut pas à celui attribué aux écoles anglophones.
Dans la foulée de l’adoption de la Loi sur les langues officielles en 1969, la communauté francophone de Colombie-Britannique revendique aussi un meilleur accès aux services en français dans les secteurs de la justice, la santé et d’autres services fédéraux, de même qu’une plus ample diffusion de la programmation de Radio-Canada. Dans le cadre des négociations constitutionnelles ayant marqué la scène politique nationale dans les années 1980 et 1990, la FFCB exhorte les pouvoirs publics à mieux reconnaître les besoins de la communauté dans l’objectif de freiner l’assimilation linguistique, dont le taux est particulièrement élevé dans la province.
L’identité francophone en Colombie-Britannique
Réunie sous un drapeau (dévoilé en 1982) arborant la fleur de lys et le cornouiller, emblème floral de la province, et traversé de bandes bleues évoquant la mer et les montagnes, la communauté francophone en Colombie-Britannique s’est toujours caractérisée par la diversité ethnique et sociale de ses membres. Bien que longtemps associée à un héritage canadien-français et catholique, l’identité francophone sur la côte pacifique a été profondément transformée par l’augmentation et la diversification de l’immigration ainsi que par la sécularisation de la société qui ont marqué la deuxième moitié du 20e siècle. Des francophones des autres provinces canadiennes et d’Europe gonflent chaque année les rangs de la communauté, laquelle s’enrichit d’un nombre croissant de nouveaux arrivants provenant d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est. De ce fait, la vaste majorité des francophones habitant la Colombie-Britannique est née ailleurs que dans la province et c’est davantage par l’utilisation de la langue française que par un patrimoine culturel commun que se définit cette identité hétérogène. D’ailleurs, le vocable « Franco-Colombien », répandu durant la période d’après-guerre tombe en désuétude avant la fin du siècle, remplacé par le terme « communauté francophone », plus inclusif et désormais couramment utilisé.

Cette identité linguistique s’exprime à travers une panoplie d’organismes associatifs, culturels, éducatifs, d’affaires et d’entraide proposant des services et des activités en français partout dans la province. Outre la scolarisation au primaire et au secondaire, des programmes postsecondaires sont offerts en français par l’Université Simon Fraser et par le Collège Éducacentre. Malgré la fermeture du journal Le Soleil de Colombie-Britannique en 1998 puis de L’Express du Pacifique en 2011, le service régional de Radio-Canada ainsi que le journal bilingue The/La Source continuent de couvrir l’actualité francophone britanno-colombienne. De multiples organismes offrent des services spécialisés, dont La Boussole venant en aide aux francophones dans le besoin, Réseau-Femmes en soutien aux femmes francophones, ou encore la Société de développement économique destinée aux entrepreneurs francophones. À travers la province, les francophones de tous horizons se retrouvent autour d’activités culturelles et sociales proposées par des associations locales. Sur le plan de la culture, le Festival du Bois fait résonner chaque année les traditions musicales et culinaires d’ici et d’ailleurs, le Théâtre la Seizième et les Rendez-vous du cinéma divertissent par leurs programmations variées, et la Société historique francophone assure la pérennité des archives de la communauté.
Ces archives rappellent les origines francophones de la Colombie-Britannique moderne dans le commerce des fourrures et la colonisation européenne de la côte pacifique canadienne. Les noms associés à cette époque continuent de marquer la toponymie des quatre coins de la province, mais le visage de cette communauté n’a cessé d’évoluer au fil des deux derniers siècles.
Voir aussi Canadiens français dans l’Ouest; Littérature de langue française dans l’Ouest

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom