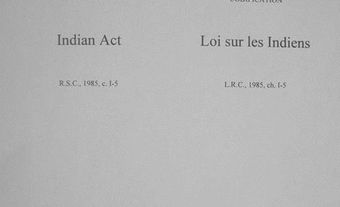En raison de la très grande diversité des Premières Nations, des Métis et des Inuits au Canada, les droits des Autochtones se prêtent mal aux généralisations. Toutefois, les droits des Autochtones sont des droits inhérents et collectifs issus de l’occupation du territoire que l’on appelle aujourd’hui le Canada, et des ordres sociaux en place avant l’arrivée des colons européens en Amérique du Nord. Pour beaucoup, le concept des droits autochtones se résume au droit à l’indépendance et à l’autodétermination en matière de gouvernance, de territoire, de ressources et de culture.

Quels sont les droits des Autochtones au Canada?
Les droits des Autochtones sont difficiles à définir au Canada en raison de la diversité des peuples autochtones. Par exemple, les Premières Nations signataires de traités avec le gouvernement fédéral peuvent jouir de privilèges (comme des paiements de transfert annuels) auxquels les nations sans traités n’ont pas droit. De façon similaire, les nations autochtones qui ont gagné leurs revendications territoriales devant les tribunaux exercent un contrôle plus important que d’autres sur leur territoire et leur population. Cela étant dit, en général, tous les peuples autochtones disposent de certains droits protégés, qui peuvent inclure le libre accès aux terres et aux ressources ancestrales et le droit à l’autonomie gouvernementale.
En plus des traités, qui sont censés garantir les droits relatifs au territoire, aux ressources et bien plus, le droit fédéral protège aussi les droits des Autochtones, notamment par la Loi constitutionnelle de 1982 (voir Constitution du Canada). Depuis 2008, les droits des Premières Nations vivant dans les réserves sont également couverts par la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Cour suprême clarifie les définitions se rapportant aux droits des Autochtones, en particulier en ce qui a trait aux droits (ou titres) des Autochtones par rapport au territoire traditionnel. Par exemple, l’affaire Delgamuukw de 1997 permet de statuer que le titre autochtone est un droit ancestral protégé par la Constitution.
La Loi sur les Indiens (une autre loi fédérale), bien que ne garantissant aucun droit (elle est, au contraire, une grande source d’oppression historique), a néanmoins un grand impact sur les droits des Autochtones au Canada. En créant deux catégories, les Indiens inscrits et les Indiens non inscrits, la Loi cause certaines tensions au sein des peuples autochtones (voir Livre blanc de 1969 et Femmes autochtones et droit de vote). Par exemple, les Indiens inscrits profitent de certains privilèges particuliers que les Indiens non inscrits n’ont pas, comme l’exemption de taxes provinciales et fédérales sur certains produits s’ils vivent ou travaillent dans les réserves. Un grand nombre d’Autochtones (inscrits et non inscrits), cependant, refusent d’être définis par cette loi fédérale.
Les droits des Autochtones sont également défendus et contestés à l’échelle provinciale et locale. Plusieurs Premières Nations signent des accords sur leurs revendications territoriales avec les gouvernements fédéral et provinciaux. Lorsque les droits territoriaux sont contestés, les rapports entre ces groupes deviennent moins amicaux. La crise d’Oka et la crise d’Ipperwash sont des exemples importants de protestations nées du non-respect des droits territoriaux des Autochtones par les autorités locales et provinciales. Depuis l’arrivée des Européens, les peuples autochtones ont toujours dû lutter pour protéger leurs droits, leurs terres, leurs citoyens et leur mode de vie.
Origines des droits autochtones
Les peuples autochtones utilisent à travers l’histoire trois arguments pour affirmer leurs droits : la loi internationale, la Proclamation royale de 1763 (ainsi que les traités qui l’ont suivie) et le droit commun (common law), comme défini par les tribunaux canadiens.
Sur la scène internationale, les groupes autochtones travaillent avec les Nations Unies, qui se préoccupent des droits accordés aux populations autochtones et aux minorités visibles. Bien que la plupart des nations du monde adoptent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2007 – une entente qui reconnaît aux Autochtones les droits de la personne fondamentaux, ainsi que le droit à l’autonomie gouvernementale, au territoire, à l’égalité et à la langue –, le Canada ne la signe qu’en mai 2016, après un changement de gouvernement fédéral. En effet, Ottawa refuse initialement d’adopter la Déclaration en raison de clauses entourant les litiges fonciers et l’obligation de consentement, qui pourraient affecter négativement le développement des ressources. À l’heure actuelle, on ignore toujours comment le Canada prévoit mettre en œuvre cet accord.
Au pays, la Proclamation royale de 1763 est historiquement considérée comme la base constitutionnelle des droits juridiques et issus de traités des Autochtones. Les principes juridiques de la Proclamation, réaffirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sont encore utilisés aujourd’hui dans la négociation des traités modernes.
L’inclusion de l’article 35 dans la Constitution annonce le début d’une nouvelle ère juridique et politique en ce qui a trait aux questions autochtones. En effet, l’article protège une vaste gamme de droits autochtones et issus de traités, y compris la reconnaissance juridique des pratiques coutumières comme le mariage et l’adoption, le droit de récolte traditionnelle sur le territoire et d’autres droits qui ne sont pas liés aux revendications territoriales elles-mêmes, en plus de protéger le droit de propriété des terres ancestrales.
Les tribunaux, et plus spécifiquement la Cour suprême du Canada, clarifient et garantissent également plusieurs droits autochtones, dont le droit d’exploiter le territoire et ses ressources. Comme les gouvernements n’arrivent pas à s’entendre au cours des négociations constitutionnelles entourant les droits autochtones, c’est l’appareil juridique qui doit trancher sur la question. Les décisions prises au cours de ces procès sont intégrées à la loi canadienne et ont le pouvoir de changer la façon dont le gouvernement perçoit les droits autochtones. L’affaire Calder, par exemple, prépare le terrain pour les revendications territoriales de nombreuses Premières Nations en Colombie-Britannique et pour beaucoup d’autres affaires liées aux titres autochtones.
Droits relatifs aux ressources
Souvent dans l’histoire, les peuples autochtones sont appelés à prouver leurs droits devant les tribunaux canadiens. Pour les droits relatifs aux ressources n’étant pas liés à un titre autochtone, la Cour suprême statue que les peuples autochtones doivent démontrer que le droit revendiqué est une partie intégrale de leur société distinctive qui leur a été arrachée aux premiers contacts avec les Européens (voir Affaire Van der Peet et Affaire Pamajewon). Autrement dit, pour que les pratiques comme la pêche et la chasse deviennent des droits garantis sur le plan juridique, les peuples autochtones doivent prouver que ces activités avaient lieu avant l’arrivée des Européens. Les tribunaux ont tendance à voir le commerce du poisson et des fourrures, notamment, comme un résultat du contact des Européens plutôt qu’un élément intrinsèque du mode de vie des sociétés autochtones avant la colonisation. Cela dit, la pêche à des fins alimentaires, communautaires ou cérémoniales est un droit reconnu par la loi et peut être pratiquée avec les méthodes et l’équipement contemporains.
Les peuples autochtones se réfèrent à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pour affirmer leurs droits d’exploitation des ressources comme la pêche. Dans l’affaire Sparrow en 1990 (la première fois que la Cour suprême offre une interprétation de l’article 35), un Autochtone pêche sans suivre les dispositions de la loi fédérale. L’accusé se défend alors en alléguant que la pêche est un droit ancestral protégé par un traité en vertu de l’article 35. La Cour suprême lui donne raison et élabore un code d’interprétation de cet article qui n’impose aucune limite aux types de droits auxquels les Autochtones peuvent prétendre. La Cour suprême souligne l’importance de se montrer « souple » et « ouvert au point de vue des Autochtones » dans l’interprétation de tels droits. Elle statue cependant que l’article 35 ne rétablit pas les droits qui ont été éteints (c.-à-d., cédés) avant 1982, année d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle.
Les peuples autochtones défendent également leurs droits relatifs aux ressources et au territoire à l’extérieur des palais de justice. À coups de manifestations contre les entreprises d’exploitation et le gouvernement qui cherchent à contourner leurs droits ancestraux, les Autochtones démontrent leur pouvoir de mobilisation, mais aussi leur désir de dialoguer et d’être consultés lorsqu’il est question des terres traditionnelles et des droits connexes. À titre d’exemples notables de protestation autochtone, citons le mouvement Idle No More; la « guerre dans le bois » (de 1984 à 1993), une manifestation menée par les Tla-o-qui-aht et leurs alliés pour la protection des forêts anciennes; les manifestations contre le pipeline de la vallée du Mackenzie et le pipeline Keystone XL (voir Pipelines au Canada).
Titre autochtone
Certains procès importants permettent de définir le titre autochtone. C’est le cas de l’affaire Calder de 1973, qui reconnaît pour la première fois que les titres autochtones ont leur place dans la loi canadienne. Dans le cadre de l’affaire Delgamuukw, en 1997, la Cour suprême juge que les revendications sur les terres traditionnelles doivent démontrer qu’une société autochtone est la seule occupante du territoire disputé au moment où la Couronne affirme sa souveraineté sur le territoire. Pendant ce procès, la Cour suprême statue que les récits oraux des peuples autochtones constituent une preuve historique suffisante pour démontrer l’occupation et l’utilisation d’un territoire. En 2014, l’affaire Tsilhqot’in précise davantage les critères du titre autochtone, qui sont triples : un groupe autochtone doit d’abord prouver son occupation du territoire pour ensuite en démontrer la continuité et l’exclusivité.
Malgré ces trois procès, la Cour suprême ne parvient pas à résoudre tous les enjeux juridiques entourant le titre autochtone. En effet, le lien entre un titre autochtone et le droit exclusif d’utilisation et d’occupation du territoire n’a jamais été clarifié. Cette ambiguïté crée de sérieux problèmes, en particulier pour les entreprises d’exploitation et d’autres intérêts qui cherchent à poursuivre ou à développer leur utilisation de ces territoires. Plusieurs procès sur la question, notamment ceux impliquant les Nuu-chah-nulth, en Colombie-Britannique, sont portés en justice. Dans la plupart des cas, les décisions de la Cour suprême garantissent le respect des exigences administratives par les entreprises, tout en les laissant exploiter les ressources et développer le territoire, si cela sert l’intérêt du public général. L’obligation de consultation, un élément phare de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, est affirmée au Canada par la Cour suprême dans l’affaire Delgamuukw.
Droit à l’autonomie gouvernementale
Même s’il n’existe toujours pas de définition officielle pour les droits autochtones dans la loi canadienne, la plupart des peuples autochtones soutiennent que le droit à l’autonomie gouvernementale en fait partie. La Cour suprême, quant à elle, n’a jamais directement abordé la question, qui est néanmoins étudiée en profondeur par la Commission royale sur les peuples autochtones, qui rend son rapport au gouvernement fédéral en 1996. La Commission propose plusieurs solutions pour renouveler la relation entre le gouvernement canadien et les peuples autochtones, y compris la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale, le règlement des revendications territoriales, l’adoption de certaines mesures pour éliminer les inégalités entre les Autochtones et les non-Autochtones au Canada et la création d’un système de justice autochtone.
L’un des meilleurs exemples de gouvernance autochtone au pays est l’Accord définitif Nisga’a, ratifié après 25 ans de négociations suivant l’affaire Calder de 1973 (voir Nisga’a). La teneur du traité et sa ratification donnent lieu à d’intenses débats qui seront portés devant les tribunaux. À son adoption, en 2000, l’Accord devient le premier traité moderne de Colombie-Britannique et le 14e à être négocié au Canada entre 1975 et 2000. L’Accord définitif Nisga’a donne aux Nisga’a le droit de se gouverner sur le territoire traditionnel de 2 019 km2 qu’ils possèdent dans la vallée de la Nass. De 1973 à 2015, plus de 26 revendications territoriales globales et 4 ententes sur l’autonomie gouvernementale sont conclues au Canada.
L’Accord définitif Nisga’a révolutionne le processus de négociations de traités en Colombie-Britannique, car il concrétise les aspirations exprimées par les tribunaux dans l’affaire Delgamuukw en matière de négociations d’ententes. Grâce à cet accord, d’autres Premières Nations peuvent aujourd’hui défendre leurs revendications. Les Premières Nations Tsawwassen et Maa-nulth finalisent respectivement des ententes en 2009 et en 2011. En juillet 2017, ce sont 58 revendications territoriales globales qui sont en négociation en Colombie-Britannique, tandis que 7 autres en sont à la phase de mise en œuvre.
Teneur des droits autochtones
Aucun droit autochtone, même ceux qui bénéficient d’une protection constitutionnelle, n’est absolu au Canada. Les droits de pêche, par exemple, ne sont pas exclusifs aux Autochtones. Ils n’échappent pas non plus aux réglementations gouvernementales. Le titre autochtone, pour sa part, peut engendrer un droit exclusif d’utilisation et d’occupation du territoire. Ce droit peut toutefois être enfreint par le gouvernement à des fins de développement économique, de production énergétique, ou encore de protection de l’environnement ou d’espèces menacées. Les gouvernements non autochtones doivent donc justifier toute atteinte à un droit ou à un titre autochtone en démontrant que l’infraction vise un objectif législatif impérieux et réel, tout en reconnaissant qu’il affecte les droits constitutionnels protégés. Les gouvernements peuvent également être contraints de consulter les peuples autochtones concernés et, dans certains cas, de les indemniser.
Obligation de consulter
L’obligation qu’ont les gouvernements du Canada de consulter les groupes autochtones est confirmée par la Cour suprême du Canada en 2014, en vertu de ses décisions dans l’affaire Grassy Narrows et l’affaire Tsilhqot’in. En Ontario, le procès de la Première Nation de Grassy Narrows promeut la notion selon laquelle les gouvernements provinciaux, s’ils peuvent choisir d’enfreindre les traités territoriaux à des fins de développement, doivent en revanche assumer les mêmes responsabilités de consultation que le gouvernement fédéral.
Dans l’affaire Tsilhqot’in, la Cour suprême reconnaît aux Tsilhqot’in le titre et l’autorité autochtones en ce qui a trait à un territoire traditionnel de 1 750 km2 au centre de la Colombie-Britannique. En adoptant une interprétation large du titre autochtone, la Cour suprême amorce une ère nouvelle en matière de développement des ressources et de consultation des groupes autochtones dans les régions canadiennes qui n’ont pas été cédées par des traités historiques. Cela suggère qu’à l’avenir, la Couronne ne sera plus seulement tenue de consulter les Autochtones, mais qu’elle devra également obtenir leur consentement ou satisfaire aux exigences juridiques qui justifient une atteinte aux droits autochtones.
Droits des femmes autochtones
Pendant les années 1970 et 1980, les femmes autochtones intentent un certain nombre d’actions contre le gouvernement fédéral à l’égard de la discrimination juridique et de genre de la Loi sur les Indiens. Depuis 1869, la Loi dicte qu’une femme inscrite qui épouse un homme non inscrit perd tous les droits autochtones et issus des traités dont elle jouissait avant son mariage (voir Les femmes autochtones et le droit de vote). En 1985, la Loi C-31 vient modifier la Loi sur les Indiens pour en retirer les dispositions discriminatoires et l’harmoniser à la Charte canadienne des droits et libertés.
La révision de 1985 permet aux femmes ayant épousé un non-Autochtone (et aux enfants nés de cette union) de demander le rétablissement de leur statut et de leurs droits autochtones. La Loi n’exige plus des femmes qu’elles se plient aux désirs de leur époux en ce qui concerne le statut d’Indien, et permet aux femmes de léguer leur statut à leurs enfants, comme cela a toujours été le cas pour les hommes.
Si la modification de la Loi permet d’éliminer une grande partie de la discrimination envers les femmes autochtones, elle crée cependant d’autres problèmes. En effet, en ajoutant ces femmes et leurs enfants à la liste des membres de bandes autochtones, le gouvernement force les Premières Nations à partager ses territoires et ses ressources limitées auprès d’un plus grand nombre de personnes. Certains membres des Premières Nations, conséquemment, voient d’un œil peu favorable l’arrivée de ces « Indiens de la Loi C-31 ».
En outre, l’inclusion d’une règle d’inadmissibilité de la seconde génération signifie qu’un grand nombre d’Autochtones n’ont plus accès au statut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens. Selon la Loi C-31, il existe deux critères qui octroient le droit d’être inscrit au Registre des Indiens. Le premier critère, issu du paragraphe 6(1), s’applique à ceux dont les deux parents sont inscrits ou peuvent l’être. Le second critère, défini au paragraphe 6(2), s’applique aux enfants nés d’un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(1). Les enfants nés d’un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(2), eux, ne peuvent être inscrits. Autrement dit, après deux générations d’intermariage, les enfants ne sont plus admissibles au statut d’Indien. De plus, pour qu’un enfant soit inscrit au Registre, le nom des deux parents doit figurer sur son acte de naissance. Si le nom du père n’est pas inclus, alors l’enfant n’est pas admissible. Les enfants nés d’une femme inscrite en vertu du paragraphe 6(2) ne peuvent être inscrits. Les modifications à la Loi réduisent donc de façon considérable les possibilités de léguer le statut d’Indien aux générations futures.
La Loi C-31 élimine également la disposition « mère grand-mère », qui confère un statut à des personnes dont la mère et la grand-mère paternelle n’étaient pas des Indiennes avant leur mariage, mais seulement jusqu’à 21 ans. L’élimination des effets de cette disposition crée une nouvelle inégalité qui complique la transmission du statut dans certains cas.
En réponse à la décision de la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans l’affaire McIvor c. Canada (2009), la Loi S-3, votée en 2010, tente d’assurer la parité du statut des petits-enfants des femmes ayant marié un non-Autochtone et de ceux touchés par la disposition « mère grand-mère ». Actuellement en examen au Parlement, la Loi S-3, créée en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada en 2015, cherche à éliminer les iniquités concernant les personnes admissibles à l’enregistrement en vertu des paragraphes 6(1) et 6(2).
Extinction des droits autochtones
Par extinction, on entend le retrait ou la cession des droits. Historiquement, les traités et les règlements territoriaux ont pour but d’éteindre les droits des Autochtones. Jusqu’à 1982, toutes les instances juridiques reconnaissent le pouvoir du Parlement d’éteindre les titres et les droits autochtones, bien que cela ne soit jamais fait expressément. Les droits de pêche et de chasse autochtones sont néanmoins limités par des modifications constitutionnelles, des lois fédérales et, à l’occasion, des lois provinciales. Dans la décision de l’affaire Sparrow, en 1990, la Cour suprême juge que les droits peuvent être réglementés si le règlement peut être justifié. Dans l’affaire Delgamuukw, la Cour suprême n’écarte pas la possibilité d’une extinction de droits après 1982, mais insiste longuement sur l’importance de la consultation et de l’indemnisation lorsque les droits sont éteints.
Dans l’affaire Bear Island, dont la Cour suprême rejette l’appel en 1991, on avance que le fait de tarder à engager une action en justice suffit à faire échec à une revendication de titre autochtone. Ce seul fait, s’il est admis par la loi, permettrait donc de faire échec à n’importe quelle revendication territoriale portée devant les tribunaux. De plus, la Première Nation signe en 1850 un traité qui éteint ses droits. Dans l’affaire de la rivière Blueberry, en 1995, la Cour suprême met en application une période de prescription pour annuler une partie de la revendication de la Première Nation en ce qui a trait à la cession des terres de réserves et des droits miniers.
Historiquement, les lois fédérales encouragent la négation des droits des peuples autochtones. La Loi sur les Indiens, au fil du temps, retire nombre de droits fondamentaux aux Autochtones, notamment le droit de célébrer des potlatchs et des danses, et de pratiquer les religions autochtones. L’émancipation volontaire ou forcée – le processus juridique par lequel un Autochtone perd son statut d’Indien inscrit – promeut quant à elle l’extinction des droits autochtones en échange des droits de citoyenneté canadienne (voir Droit de vote des peuples autochtones). D’autres mesures fédérales mènent également à l’assimilation des peuples autochtones en les privant de leurs droits, notamment la mise en place des pensionnats indiens et le système de laissez-passer (une politique qui exige des Autochtones désireux de quitter leur réserve qu’ils obtiennent un laissez-passer auprès d’un agent, sans égard à la durée du départ).
Droits des Métis
Les droits des Métis sont principalement définis et clarifiés par les tribunaux. L’affaire R. c. Powley de 2003, en particulier, permet d’affirmer le droit traditionnel des Métis de pratiquer la chasse de subsistance, et constitue la première instance où la Cour suprême du Canada reconnaît officiellement l’existence des droits métis. Cette affaire mène également à la création d’un test pour déterminer les droits des Métis en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. S’appuyant sur dix critères, le test Powley définit l’identité métisse et les droits préexistants des collectivités métisses, notamment la chasse.
L’identité métisse en tant que telle se détermine par trois critères : se considérer comme Métis; être membre d’une collectivité métisse contemporaine; entretenir des liens avec une collectivité métisse historique. Ce dernier point est également soumis à certains critères que les membres doivent prouver : que le groupe d’ascendance autochtone forme une identité collective sociale « distincte », que le groupe vit ensemble dans la même zone géographique et qu’il partage un même mode de vie.
L’affaire R. c. Powley statue ainsi que l’identité métisse réfère au lien avec une collectivité distincte, et pas seulement à l’ascendance européano-autochtone. Ceux et celles qui se déclarent Métis, mais qui ne satisfont pas aux critères mentionnés ci-dessus – c’est-à-dire les personnes vivant à l’extérieur du territoire défini par le Ralliement national des Métis, qui comprend l’Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan et certaines parties de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest – voient l’affaire R. c. Powley comme une atteinte à leur identité. Pour les personnes capables de prouver que leur lignée remonte à des communautés métisses historiques, toutefois, l’affaire R. c. Powley valide un argument longtemps débattu selon lequel elles font partie d’une communauté autochtone distincte (voir Les Métis sont un peuple, pas un processus historique et « Autres » Métis).
L’affaire Daniels (2016) contribue aussi à l’avancement des droits des Métis. Le 14 avril 2016, la Cour suprême juge à l’unanimité que la définition légale d’« Indien » –telle que décrite dans la Constitution – s’applique désormais aux Métis et aux Indiens non inscrits. La décision facilite ainsi les futures négociations entourant les droits ancestraux sur le territoire, ainsi que l’accès à l’éducation, aux programmes de santé et à d’autres services gouvernementaux. Elle n’octroie cependant pas le statut d’Indien aux Métis et aux Indiens non inscrits.
Droits des Inuits
Les Inuits appartiennent à la catégorie « Indiens » de la Loi constitutionnelle de 1982 et, en tant que tels, leurs droits sont protégés en vertu de l’article 35. Malgré ce fait, les Inuits ne sont pas inclus dans la Loi sur les Indiens, et sont largement ignorés par le gouvernement fédéral jusqu’en 1939, lorsqu’un jugement du tribunal les met sous sa responsabilité. À la suite de cette décision (qui exclut toujours les Inuits de la Loi sur les Indiens), une foule de politiques d’assimilation, comme des déménagements forcés dans des collectivités sédentaires et le système de médaillons numérotés (voir Projet Noms de famille et Lieu historique national de la Mission-de-Hebron) sont mises en place.
Différents traités et règlements de revendications territoriales confirment les droits fonciers des Inuits dans le nord du Canada, dont la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975), la Loi sur le règlement des revendications des Inuvaluit de la région ouest de l’Arctique (1984), l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993) et l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador (2005). Ensemble, ces quatre régions couvrent environ 40 % de la masse terrestre du Canada.
Une instance particulièrement importante dans la reconnaissance des droits des Inuits est l’affaire Clyde River, en 2017, qui oppose les Inuits vivant aux alentours de Clyde River, au Nunavut, à l’Office national de l’énergie (ONE). Les Inuits luttent alors contre les plans de l’ONE, qui souhaite effectuer une prospection séismique du pétrole et du gaz dans la région depuis 2011. Devant la Cour suprême, les Inuits de Clyde River font entendre leur cause : les juges décident à l’unanimité que l’ONE a failli à son obligation de consulter de façon appropriée les Inuits, en plus de n’avoir pas évalué correctement les effets qu’une prospection séismique aurait sur les droits des peuples autochtones. Contrant les plans de l’ONE, la Cour suprême met fin aux essais séismiques. Bien que cette dernière ne fournisse pas de lignes directrices à ce sujet, elle met en lumière l’importance de la consultation des peuples autochtones.
Sur la scène internationale, diverses déclarations, comme celle des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, confirment aux peuples inuits leurs droits sur les terres et les eaux de l’Arctique.
Perspectives d’avenir
La portée et la priorité des enjeux entourant les droits et les titres autochtones continuent d’évoluer, tant sur le plan juridique qu’à travers les négociations et la mise en œuvre d’ententes sur l’autonomie gouvernementale entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada. À long terme, il est probable que ces enjeux doivent être abordés par un règlement politique négocié.

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom